Articles récents
- “Nous tirer une balle dans le pied” (par Jo Brew)
- “Les Women’s Studies et les hommes”, de Renate Klein (par Annie Gouilleux)
- « La passion de l’amitié, vers une philosophie de l’affection féminine » de Janice Raymond (par Annie Gouilleux)
- Au pays de la « vache sacrée » : un spécisme à l’indienne (par Ana Minski)
- Mary Daly, Gyn/ecology, métaphysique du féminisme radical (par Annie Gouilleux)
Liens
- Mouvement du nid
- Ressources prostitution
- La révolution sera féministe
- Blog Révolution féministe
- Tradfem
- Scènes de l’avis quotidien
- Sniadecki – Critique de la science
- Les amis de Bartleby
- Sciences-critiques
- Polemos – Postcroissance
- Coalition internationale contre la maternité de substitution
- Podcast Rebelles du genre
Activisme Aliénation Anarchisme Andrea Dworkin Annie Gouilleux Anthropologie Antiprogressisme Archéologie Art paléolithique Aurélien Berlan Biogynophobie Capitalisme Capitalisme vert Charles Stepanoff Chasse Critique de la civilisation critique de la science Culture masculiniste Domestication Démystification Enfance Francis Dupuis-Déri Féminisme Féminisme radical GPA Histoire Identité de genre ITW Littérature Note de lecture Patriarcat Poésie Prostitution Racisme Revue Behigorri Rêve Sagesses Incivilisées Technocritique Technoscience transactivisme Transhumanisme Vidéos Violence masculine Écoféminisme Écologie

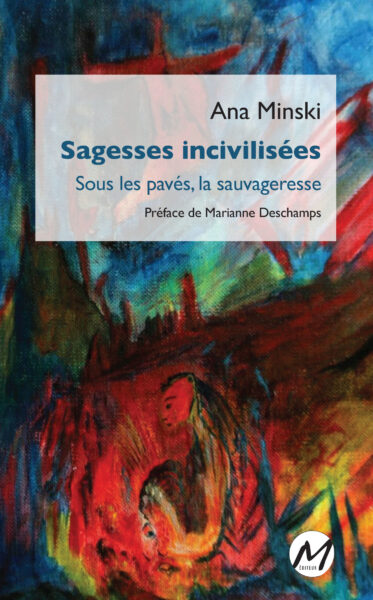
Illustration de couverture : Oksana Shachko
pdf. en téléchargement
Certains mouvements féministes accordent encore aujourd’hui une crédibilité à la théorie du matriarcat, primitif et contemporain, et de la déesse-mère bien qu’aucune preuve ne vienne en confirmer l’existence, bien au contraire.
L’origine de cette construction intellectuelle est due à l’interprétation très personnelle de différents auteurs s’appuyant essentiellement sur les mythes des peuples autochtones et les différentes productions iconographiques — statuettes, signes, motifs, objets divers — du Paléolithique et du Néolithique. Elle a été théorisée par des scientifiques à la fin du XVIIIe siècle pour justifier une vision hiérarchisante des sociétés.
La construction d’un mythe
À partir de la fin du XVIIIe siècle, de nombreux scientifiques développèrent des thèses évolutionnistes pour distinguer — et souvent hiérarchiser — les sociétés entre elles selon des différences techniques, culturelles, iconographiques.
L’évolutionnisme culturel, né sous la plume des philosophes des Lumières, envisageait l’histoire des sociétés humaines sous l’angle d’une progression du plus simple au plus complexe. Selon cette perspective progressiste, inspirée de l’ontogenèse humaine, les sociétés dites « naturelles », « simples », « primitives » représentaient l’enfance de l’humanité tandis que les sociétés dites civilisées représentaient les stades les plus évolués, les plus achevés. Nous savons aujourd’hui que ces stades évolutifs ne sont pas si évident. En effet, certains peuples ont abandonné l’agriculture pour redevenir chasseur-cueilleur, d’autres ont refusé l’agriculture et/ou la domestication animale. Bien que non urbanisés, leurs cultures symboliques, spirituelles, sociales est tout aussi complexe, parfois même plus, que celle des civilisés. Cet évolutionnisme, chargés de jugements de valeurs, est à l’origine de la confusion entre les humains du Paléolithique et les chasseurs-cueilleurs actuels qui ont longtemps été perçus comme des êtres « primitifs », c’est-à-dire sans histoire et incapable de s’extraire (du moins sans l’aide des civilisés) de l’enfance de l’humanité.
S’appuyant sur ces stades évolutifs, différents états biologiques, techniques, intellectuels et religieux seront théorisés.
En 1758, Carl von Linné (1707-1778), fondateur de la taxinomie moderne, établit une « classification continentale des races ». L’homme est pour la première fois classé avec les primates. L’influence et l’autorité de Georges Cuvier, de ses collègues et de leurs successeurs au Muséum d’Histoire naturelle, cristalliseront cette hiérarchisation classant les « Boschimans » et « Hottentots » au plus bas de l’échelle humaine, à la charnière de l’animalité1.
En 1820, Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865) classifie les périodes préhistoriques selon les matériaux utilisés, à un premier âge de la pierre succède un âge du bronze puis un âge du fer. Ce système des trois âges sera entériné au XIXe siècle, siècle du renforcement des nationalismes, du développement des conquêtes coloniales et du progrès industriel. L’innovation technique est alors perçue comme le principal facteur déterminant du changement social2 et, par conséquent, de l’idée de progrès qui considère que l’innovation technique est sans fin, limitée par aucune nature. Cette idéologie progressiste domine encore largement nos rapports à la nature et aux autres espèces. Dans la même logique évolutionniste, les religions monothéistes parlent de religions archaïques.
À partir de 1839, Auguste Comte (1798-1857) distinguera trois états selon une évolution intellectuelle : un premier état (enfantin) dit théologique, ou fictif, un second état (adolescent) dit métaphysique, ou abstrait, et enfin un état (adulte) dit scientifique, ou positif3.
Le mythe scientifique de la société matriarcale originelle s’inscrit dans la continuité de ces différentes théories scientifiques et sera théorisé en 1861 par Johann Jakob Bachofen (1815-1987), dans son ouvrage Le droit maternel. Bachofen croit trouver la trace d’un matriarcat originaire qui aurait précédé le patriarcat.
La thèse avancée par Bachofen est une vision simplificatrice des sociétés étudiées. D’une part, elle nie les divers contextes archéologiques, historiques et culturels des nombreux mythes et déesses de l’Antiquité et qui ont été mobilisés pour élaborer cette théorie. D’autre part, elle maintient une dangereuse confusion entre mythe et réalité sociale effective.
Néanmoins, de nombreux auteurs, de l’anthropologue américain Lewis H. Morgan (1877), en passant par le philosophe et théoricien socialiste allemand Friedrich Engels (1884) et le fondateur de la psychanalyse Sigmund Freud (1922), s’en sont inspirés, participant ainsi à diffuser la croyance en une déesse-mère et en un matriarcat originaire.
Dans les années 1930, Petr Petrovitch Efimenko (1884-1969) fut le premier archéologue à considérer que l’art du Paléolithique récent confortait l’existence d’un matriarcat primitif. La découverte les statuettes paléolithiques dites « vénus »4 sur le site de Kostienki, ne pouvaient, selon lui, représenter autre chose que la déesse-mère. Ces figurines ne pouvaient que témoigner de l’importance qu’accordaient ces communautés aux femmes. Le rôle de ces dernières devait être essentiel dans la vie sociale et économique des communautés paléolithiques, forcément régies par un matriarcat. Efimenko imagine la femme du Paléolithique comme une maîtresse du foyer, du feu et de la puissance magique nécessaire au succès de la chasse.
En 1938, Vittore Pisani (1899-1990) affirmait que le même système matriarcal, polyandre et adorateur de la déesse-Terre, aurait partout régné de la Méditerranée à l’Inde avant l’arrivée des Indo-Européens5 et des Sémites. En 1959, Edwin Oliver James (1888-1972) publia Le Culte de la déesse-mère dans l’histoire des religions, dans lequel il interprète les gravures des Combarelles comme autant de représentations d’une « danse rituelle de fécondité »6. En 1989, c’est l’archéologue Marija Gimbutas (1921-1994), dans son livre The Language of the Goddess, qui spécula sur l’existence d’une Grande Déesse. Son idée était qu’il existait au Néolithique une déesse universelle de la création. Symbole de l’unité de la nature, elle donnait la vie et assurait la régénération. Cette société, décrite comme matriarcale, célébrait l’harmonie avec la nature, le calme, la non-violence. Durant tout le Néolithique et sur toute l’Europe, la déesse avait le pouvoir de régner sur tout avant d’être supplantée lors des invasions indo-européennes, par des cavaliers envahisseurs venus de l’Europe de l’Est qui imposèrent un dieu mâle, le patriarcat et la guerre.
En 2017, la philosophe allemande Heide Göttner-Abendroth a tenté de réhabiliter le mythe matriarcal en en modifiant la définition. Le matriarcat ne serait plus un modèle social basé sur les droits maternels et l’hégémonie des femmes, mais une société fondée sur la matrilinéarité, la matrilocalité, et l’habilitation des femmes à gérer le politique, le religieux et l’économie. L’autrice de cet essai volumineux n’a pour autant pu trouver, dans le monde actuel, aucune « société matriarcale ». En effet, si le droit maternel, la matrilinéarité et la matrilocalité existent bien dans diverses sociétés, un examen approfondi permet de constater que les femmes y sont pourtant exclues du pouvoir. Elle a été également incapable de prouver l’existence d’une matriarchie originel. Envisager que la matrilocalité ou la matrilinéarité sont des survivances du Néolithique, période durant laquelle ces deux états auraient été présents ensemble pour former une société « matriarcale » est indémontrable.
Sur la base d’arguments plus sérieux, cette théorie a été largement démontée.
Aspects critiques
1. Une vision simplificatrice
Dès son origine, le mythe du matriarcat est une vision simplificatrice.
Le Néolithique est décrit comme une société monolithique et figée sur des millénaires. Les éléments disparates (mythes, système de parenté et filiation, figurations humaines, iconographies) ont été unifiées par les thuriféraires de la Grande Déesse pour leur permettre de façonner l’idée de matriarcat. Il est bon de rappeler, par exemple, que de nombreuses représentations, provenant notamment du site de Çatal Höyük, interprétées comme des « déesses parturientes » ont été redéfinies comme des silhouettes d’ours ou de léopard7.
Deux de leurs nombreux réductionnismes ont également été de confondre le « matriarcat » (les femmes possèdent le pouvoir), la matrilocalité (ce sont les hommes qui quittent leur résidence pour rejoindre celle de leur future épouse) ou la filiation matrilinéaire (les enfants portent le nom du lignage maternel, l’héritage, les terres, les noms, les maisons, se succède selon le lignage féminin), et de confondre mythe et réalité sociale.
La présence de représentations féminines dans une société ne prouve nullement que cette société soit matriarcale, qu’elle valorise la femme, la féminité, la mère, la maternité, qu’elle soit harmonieuse et pacifique. Il suffit pour cela de prendre en compte, dans notre société actuelle, le nombre de représentations de la vierge à l’enfant, des femmes présentent dans la pornographie et la publicité, et du Christ crucifié. Les archéologues du futur, si aucun texte n’est disponible pour les aider à comprendre l’imaginaire du christianisme, pourraient facilement déduire de ces représentations que nos sociétés étaient matriarcale et misandres, voire androcides. D’autre part, croire que la valorisation symbolique de la maternité et des mères serait accompagnée de la valorisation et/ou du respect de la femme est une erreur. Les politiques natalistes qui valorisent l’image de la mère n’ont jamais été respectueuses ni des femmes ni des mères. Le but de telles politiques est de motiver les femmes à engendrer, parfois une descendance nombreuse, et de se contenter du rôle de mère. Le mythe de la déesse-mère participe de la confusion entre la représentation symbolique et la réalité de la condition sociale des femmes. Enfin, la vénération d’un dieu ou d’une déesse s’accompagnait bien souvent de sacrifices humains. L’adoration d’une déesse unique ne suppose donc nullement, comme l’affirme les théoriciennes du matriarcat et de la déesse-mère, une société non violente.
2. Un récit patriarcal et hiérarchisant
C’est au mépris de la diversité des figurines et des sociétés néolithiques que les adorateurs de la Grande Déesse se sont permis de créer le concept unique de matriarcat originel, sélectionnant des faits et élaborant de nombreuses interprétations trompeuses pour alimenter ce contre modèle.
S’appuyant sur le mythe d’une matriarchie originelle présente chez un nombre important de peuples autochtones, les laudateurs de la déesse se sont bien gardés de préciser que ces récits étaient fondateurs de la domination masculine. En effet, dans ces récits mythiques, les femmes étaient tyranniques et/ou inaptes à gérer correctement les affaires de la communauté, elles incarnaient le chaos, la ruse et la sexualité débridée8. Ce mythe a donc été un moyen pour instaurer et justifier l’accaparement du pouvoir par les hommes. Rien d’étonnant donc à ce que le mythe patriarcal contribue également à la hiérarchisation des peuples. Le matriarcat étant considéré comme le stade initial d’une humanité ignorante, et plus particulièrement du rôle des hommes dans la procréation. La mère, seule capable d’engendrer de nouveaux êtres, aurait été vénérée donnant ainsi lieu au culte de la déesse-mère. Les femmes — et plus particulièrement les mères — auraient alors été la classe de sexe dominant politiquement, économiquement et idéologiquement. Pour Bachofen mais aussi Marx et Engels, le matriarcat était une organisation primitive nécessaire à l’avènement du patriarcat.
La notion de matriarcat contribue encore aujourd’hui à une vision évolutionniste des sociétés humaines. Le groupe ethnique des Na (Mosuo) du sud-ouest de la Chine a souvent été présenté comme une société matriarcale, sans père ni mari9. Contrairement à ce qu’a pu affirmer Göttner-Abendroth, les Na ont des divinités féminines ET masculines, un couple originel et non une unique déesse. Lors des rituels religieux les officiants sont toujours des hommes, les pères présentent leurs enfants lors de fêtes permettant la reconnaissance d’un lien de parenté10, les femmes ne sont libérées ni de l’obligation de la maternité ni de l’hétérosexualité, ce sont elles qui ont en charge les tâches les plus fastidieuses. Enfin, le mythe du matriarcat des Na sert le discours évolutionniste et hiérarchisant de l’État chinois, les Na étant ainsi classés au bas de l’échelle de l’évolution. Ce mythe participe aussi à rendre ce groupe exotique et attirant pour les touristes11. Si les femmes y sont plus valorisées que dans les sociétés patriarcales, elles ne sont pour autant pas les égales des hommes puisqu’elles ne détiennent ni le pouvoir de décision politique ni le pouvoir économique.
3. Le mythe des invasions « indo-européennes »
Selon Gimbutas, une série d’invasions d’un peuple dit « Indo-Européen » issu des aires steppiques du sud-est du continent, auraient mis fin aux communautés villageoises du Néolithique pour instaurer un ordre patriarcal. Archéologiquement, il existe de nombreuses preuves de conflits dès les débuts du Néolithique12. L’apparition de déités à forme humaine serait plutôt le fruit de sociétés urbanisées qui édifient des temples. Sa vision d’une invasion indo-européenne est également bien trop simpliste13. L’étude des différentes techniques qui se développent à partir de 13 000 avant notre ère14 lui aurait peut-être évité une telle simplification historique. La domestication animale, mode de production des sociétés agricoles du Néolithique, est un fait central pour comprendre les liens entre domestication animale et domination masculine15.
Conclusion
Nicole Claude Mathieu identifie le patriarcat d’après ses trois pouvoirs : pouvoir de décision politique, pouvoir de décision économique et pouvoir de possession de la terre par héritage16. Les anthropologues sont formels, il n’existe aucune société où ces trois pouvoirs sont cumulés par les femmes.
Certaines féministes pensent peut-être que s’emparer de ce mythe est un moyen pour renverser la domination masculine ? Mais comment un mythe qui hiérarchise les sexes et les peuples pourrait-il nous être d’un quelconque secours ? Comment pouvons-nous être prises au sérieux si nous nous laissons séduire par des récits aussi fumeux ? Le matriarcat, dans la mesure où il est une domination d’une classe de sexe sur une autre, est-il vraiment un système politique et économique souhaitable ?
Ce n’est pas en nous appropriant un mythe patriarcal que nous pourrons inventer une société plus juste mais en identifiant toutes les mystifications du patriarcat. Si nous voulons créer de nouvelles formes politiques et économiques, si nous voulons nous inspirer de la richesse culturelle des autres peuples sans les trahir, nous devons avant tout rester lucides sur la réalité sociale des femmes de par le monde.
Ana Minski
1 Minski A., Sagesses incivilisées. Sous les pavés, la sauvageresse, M-editeur, 2022, 184 pages.
2 Ibid.
3 Comte A., Cours de philosophie positive, édition de Charles Le Verrier, Paris, Classiques Garnier, « Littératures francophones », 2014, 2 vol.
4 Minski A., Les représentations humaines au Paléolithique récent européen, lesruminants.com : https://lesruminants.com/2021/02/12/les-representations-humaines-sexuees-au-paleolithique-recent-par-ana-minski/
5 L’hypothèse de l’existence d’un peuple indo-européen originel n’est pas acceptée par de nombreux chercheurs : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/concordance-des-temps/les-indo-europeens-realite-eclairante-ou-mythe-dangereux-4193991 ; https://www.youtube.com/watch?v=NRvfHTkEnQs
6 Le Quellec, J.-L., La caverne originelle : Art, mythes et premières humanités (p. 17-25). La Découverte, 2022, 892 pages.
7 Hodder I., The Leopard’s Tale: Revealing the Mysteries of Çatalhöyük, Londres, Thames and Hudson, 2006, 288 pages.
8 Bamberger Joan (1974), « The myth of matriarchy : why men rule in primitive society », in Michelle Zimbalist Rosaldo et Louise Lamphere (dir.), Woman, Culture, and Society, Stanford University Press, Stanford, p. 263-280.
9 Cai Hua, Une société sans père ni mari, les Na de Chine, Presses Universitaires de France, 1997, 372 p
10 Siobhán M. Mattison, Brooke Scelza, Tami Blumenfield, « Paternal Investment and the Positive Effects of Fathers among the Matrilineal Mosuo of Southwest China », août 2014, https://doi.org/10.1111/aman.12125
11 Pascale-Marie Milan, Tourisme et changement social chez les Na de Chine : étude comparée d’une coutume sexuelle : le séssé, thèse de doctorat, École doctorale des sciences sociales de Lyon, 2019. https://vimeo.com/893242594
12 Guilaine J., et Zammit J., Le sentier de la guerre, visages de la violence préhistorique, Seuil, 2001, 384 pages.
13 Demoule J.-P., Mais où sont passés les Indo-Européens ? Le mythe d’origine de l’Occident, Seuil, 2014, 740 pages.
14 « La domestication du sanglier (Sus scrofa) est datée, quant à elle, de 13 000 av. J.-C. à Chypre.
Plusieurs sites chypriotes (Aetokremnos, Klimonas et Shillourokambos) révèlent la domestication
locale des sangliers insulaires (Sus scrofa circe) mais aussi une importante migration de
mammifères dès 10 500 AP. » in Minski, op.cit, p. 29.
15 Minski A., op.cit.
16 Mathieu N.-C. (sous la direction de), Une maison sans fille est une maison morte. La personne et le genre en sociétés matrilinéaires et/ou uxorilocales, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2007, 504 pages.