Articles récents
- SHEILA JEFFREYS (par Annie Gouilleux)
- “S’engager dans la recherche et inventer une méthodologie féministe” (Renate Klein)
- RENATE KLEIN. Introduction à son œuvre (par Annie gouilleux)
- “Nous tirer une balle dans le pied” (par Jo Brew)
- “Les Women’s Studies et les hommes”, de Renate Klein (par Annie Gouilleux)
Liens
- Mouvement du nid
- Ressources prostitution
- La révolution sera féministe
- Blog Révolution féministe
- Tradfem
- Scènes de l’avis quotidien
- Sniadecki – Critique de la science
- Les amis de Bartleby
- Sciences-critiques
- Polemos – Postcroissance
- Coalition internationale contre la maternité de substitution
- Podcast Rebelles du genre
Activisme Aliénation Anarchisme Andrea Dworkin Annie Gouilleux Anthropologie Antiprogressisme Archéologie Art paléolithique Aurélien Berlan Biogynophobie Capitalisme Capitalisme vert Charles Stepanoff Chasse Critique de la civilisation critique de la science Culture masculiniste Domestication Démystification Enfance Francis Dupuis-Déri Féminisme Féminisme radical GPA Histoire Identité de genre ITW Littérature Note de lecture Patriarcat Poésie Prostitution Racisme Revue Behigorri Rêve Sagesses Incivilisées Technocritique Technoscience transactivisme Transhumanisme Vidéos Violence masculine Écoféminisme Écologie
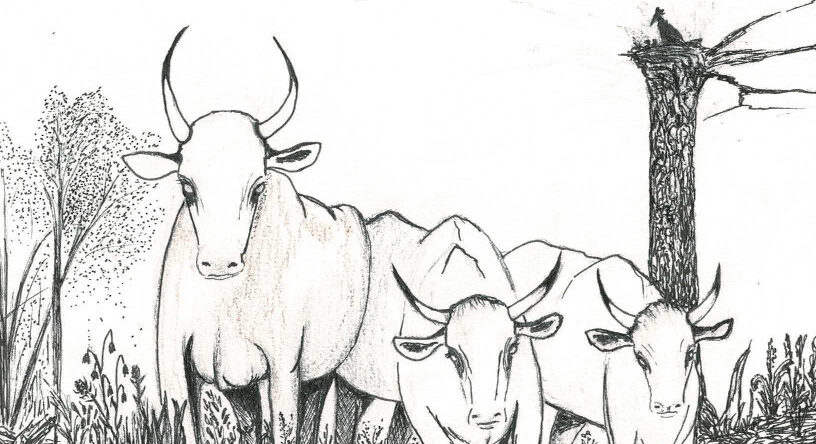
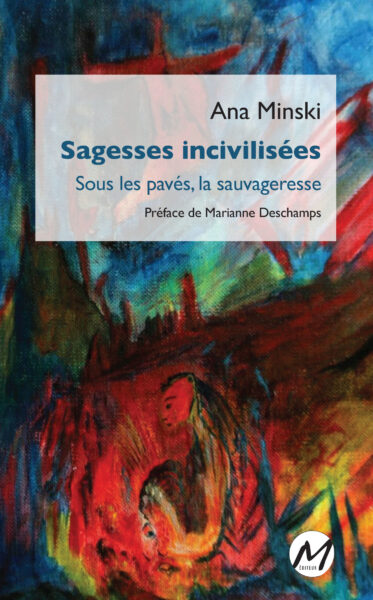
Couverture : Féralité, Ana Minski
Lors des présentations de mon essai Sagesses Incivilisées, dans lequel j’analyse, entre autres choses, le lien entre premières domestications et consolidation d’un dualisme sexuel, du patriarcat, de nouvelles formes de dominations sociales, on m’a souvent demandé ce qu’il en était au pays de la « vache sacrée » où le végétarisme dominait. Je me suis donc penchée sur cette question.
Article à télécharger en .pdf
L’Inde, avec ses 1,43 milliard d’habitants, est le pays le plus peuplé au monde. Les hindouistes représentent 79 % de sa population, c’est le pays où vivent 94 % des hindous du monde. Dans l’hindouisme moderne, la vache est « sacrée », il est interdit de la tuer et de consommer sa chair. En Inde, elle est appelée Gau Mata (Notre mère la vache), la vache y est considérée comme la mère de la nation et il est théoriquement interdit de lui faire du mal. Les vaches peuvent déambuler librement dans les rues où les touristes, moyennant quelques roupies, peuvent les nourrir ou les caresser pour profiter de leurs bons augures. Mais la vache n’est pas la seule espèce à bénéficier de soins et de protections (tout relatifs).
La religion hindouiste a influencé de nombreux auteurs occidentaux pour sa philosophie de non- violence (Ahimsa). Dès la fin du XVIe siècle, marchands et explorateurs rendent compte de l’existence de refuges, les pinjrapoles, présents un peu partout en Inde qui intriguent les Européens. Dans son Voyage en Inde, Anquetil-Duperon (1731 – 1805) visite l’Hôpital des animaux où sont soignés tortues, bœufs, singes, pigeons, lapins, etc., et où insectes, punaises et puces y sont nourris. Il y décrit également la « Fête des mouches » célébrée le 12 juillet de chaque année par les hindous. C’est par sa traduction de cinquante Upanishad, que l’Occident découvre la religion hindoue. À partir de cette période, nombreux seront les Occidentaux sensibles à la souffrance des autres espèces qui se réclameront de l’hindouisme ou s’en inspireront pour développer des philosophies compatissantes envers les autres espèces, ou pour imaginer une religion néolithique où « vache sacrée » et matriarcat auraient été liés.
Pourtant, la vision d’un hindouisme compatissant envers les autres espèces est une vision fausse. Végétarisme et sacralisation de la vache n’impliquent nullement l’absence de hiérarchie, de patriarcat, de domination envers les humains et les autres espèces.
Le lait sacré, la chair impure
S’il est jugé impur de manger la chair des vaches, son lait est à l’inverse considéré comme sacré et pur. Le lait a donc une dimension culturelle et religieuse très forte, et un poids économique qui va de pair, l’Inde étant le 1er producteur mondial de lait. Si la vache est « sacrée », il n’en est pas de même pour les mâles et les autres espèces de bovins, zébus et plus particulièrement pour les buffles d’Asie qui sont souvent noirs et figurent le démon dans la mythologie. En Inde, l’économie de la chair est tout aussi importante que celle du lait.
Le pays possède, avec ses 308 millions de bovinés1, le 1er cheptel bovin au monde. Ce cheptel est constitué de zébus (54 %), de buffles (32 %) et de croisements avec des races importées (14%). Ils sont principalement destinés à la procréation, la fumure et l’énergie (traction). Zébus mâles, bufflons et bufflonnes peuvent être abattus dans de nombreux États en vue d’en exporter la chair. Les mâles, considérés comme inférieurs parce qu’ils ne fournissent ni lait ni veau, font partie des victimes les plus fréquentes. Les hommes s’en débarrassent en les donnant à l’église ou au temple : « Bien que la loi interdise l’abattage, les veaux ainsi ‘‘donnés’’ sont en général immédiatement envoyés à l’abattoir, car les temples ne possèdent pas d’abris pour vaches appropriés.2 » L’Inde est le 5e producteur mondial et le 3e exportateur de chair bovine derrière l’Australie et le Brésil pour l’année 2023.
La population bovine se trouve très majoritairement dans des exploitations de moins de 0,5 ha, où deux bovins en moyenne fournissent lait, fumier et force de traction. Les deux tiers de cette production de chair (zébus, buffles mâles, quelques femelles) vont à la consommation domestique des chrétiens, des musulmans, des dalits (les intouchables) et des hindous les plus pauvres3. 32 % de la filière sont structurés pour l’export.
Avant 2014, l’abattage des vaches était interdit dans la plupart des États sauf dans le Kerala et l’ouest du Bengale. Avec l’arrivée au pouvoir du BJP (Bharatiya Janata Party), parti traditionaliste hindou, l’abattage des vaches est devenue strictement interdite. Mais l’abattage des buffles et des zébus mâles reste autorisé dans de nombreux États, et plus particulièrement à l’est et au Sud où vivent de nombreux musulmans. Les vaches en « fin de carrière » sont abandonnées ou livrées à elles-mêmes. Avant l’interdiction totale d’abattage, elles étaient vendues aux bouchers et à des abattoirs légaux (Kerala ou ouest du Bengale) ou illégaux. En 1997, le gouvernement découvrait 36 000 abattoirs illégaux. Ainsi que l’expose Florence Burgat, lors de son séjour en Inde en février 1998, les vaches devenues inutiles pour la production « effectuent d’immenses voyages à travers l’Inde, dans les conditions que l’on imagine, pour être abattues dans ces États4. »
La condition des vaches en Inde est loin d’être idyllique et cela ne date pas d’hier :
« Et les vaches sur la route : qui se mêlaient à la foule, qui s’affalaient parmi les affalés, flânaient parmi les flâneurs, s’immobilisaient parmi les immobiles : pauvres vaches au pelage maculé de boue, maigres à en devenir obscènes, certaines aussi malingres que des chiens, dévorées par le jeûne, le regard éternellement attiré par des objets voués à une éternelle déception. C’était presque la nuit et elles s’assoupissaient aux carrefours sous un feu tricolore, devant les portes de quelques édifices publics négligents, masses noir et gris de faim, d’égarement5. »
« Quelques vaches trainent dans cet enfer, soufflant de la poussière. Un chien mort est allongé en travers de la route. Rashmi me dit que dans quelques minutes, il n’en restera plus rien. Seuls les grands animaux sont enlevés. Les autres, laminés par les camions, s’incorporent au goudron brûlant6. »
« Les vaches fouillent dans les détritus. Certaines s’y couchent. J’ai vu des chiennes, trop maigres pour donner du lait, traînant leurs petits accrochés aux mamelles vides. Elles vont, lestées de petits au ventre7. »
« Quand on pense que les voyageurs prennent les vaches errantes pour des bêtes ‘’sacrées’’, s’imaginant sottement que rien ne leur arrive ! Il faut aller dans les refuges pour voir ces grands animaux accidentés, apprendre que, laissés sans nourriture, ils font les poubelles, avalent indistinctement les déchets, et du même coup des sacs en plastique qui renferment souvent des morceaux de verre. Leur ventre gonfle et beaucoup meurent d’occlusion intestinale8. »
Différentes espèces sont transportées dans des camions surchargés, les trajets se font sans aucune halte, sans nourriture ni abreuvement, sur de longues distances. L’abattage est si intense que l’Inde devient, en 2012, le 1er exportateur mondial de viande bovine, et en 2013 de viande de buffle. En juin 2025, ce sont plus de cinq millions d’individus bovins qui errent dans les rues9. L’abattage illégal est toujours d’actualité. Malgré sa restriction, la production de chair de bovin ne cesse de croître. Les abattages de buffles, qui représentent 84 % de la production indienne, se pratiquent dans le nord du pays, en Uttar Pradesh. Dans les États de l’est et de l’extrême sud, où la population musulmane est la plus importante, l’abattage de zébus est également autorisé.
L’abattage y est assuré par les musulmans et la communauté sikh10. Les animaux sont égorgés en pleine conscience selon les méthodes musulmanes qui interdisent de les étourdir avant de les égorger. Adoucir la mise à mort serait perçu comme une offense par la communauté musulmane. Quant aux tâches de mises à mort, les travaux de tanneries, etc., sont pratiqués par des hindous de « basse caste ». Si la tradition musulmane impose l’égorgement, la tradition hindouiste impose la décapitation. Pour les protecteurs des animaux, l’amélioration des conditions d’abattage font craindre la modernisation des abattoirs augmentant ainsi les exportations de viande considérées comme une source de revenu par le gouvernement indien, mais aussi par les filières de l’élevage français qui cherchent à importer toujours plus de viande bovine11. L’interdit d’abattage des vaches ne touche pas les buffles et bufflesses, ce qui facilite l’abattage illicite des vaches « sacrées » puisqu’il passe inaperçu au milieu des autres bovidés.
Les mauvais traitements également sont la norme. Les animaux sont laissés sans soin, sous-alimentés, surchargés, constamment brutalisés. Gandhi n’a eu de cesse de dénoncer l’hypocrisie des hindous qui brandissaient l’idéal de pureté et la croyance en la sacralité de la vache tout en les vendant aux bouchers musulmans :
« La société hindoue inflige de terribles cruautés aux vaches et aux veaux. L’état des animaux en est la preuve. Mon cœur saigne lorsque je vois des milliers de bœufs qui n’ont que la peau sur les os et sont obligés de transporter des charges excessives, alors que le conducteur les brutalise. Je frissonne en voyant cela et je me demande comment nous pouvons reprocher quoi que ce soit à nos frères musulmans tant que nous ne nous abstiendrons pas d’une telle violence. Nous sommes si profondément égoïstes que nous ne ressentons aucune honte à traire les vaches jusqu’à la dernière goutte. Si vous allez dans les laiteries de Calcutta, vous verrez que les veaux sont privés du lait de leur mère et que celui-ci est extirpé jusqu’à la dernière goutte, grâce à un procédé cruel qui consiste à souffler dans l’utérus. Les propriétaires et les responsables de ces laiteries sont des hindous et ceux qui consomment le lait aussi. Tant que prospèreront ces laiteries, quel droit aurons-nous de chercher querelle à nos frères musulmans ? On doit en outre garder à l’esprit qu’il y a des abattoirs dans toutes les grandes villes indiennes. C’est de là que provient la viande bovine fournie aux Britanniques12. »
Les humains et non-humains, devenus inutiles « meurent alors de faim, de maladie ou de malnutrition ». De nombreuses vaches « mangent beaucoup de plastique. Dans ce dernier cas, cela peut entrainer une occlusion ou une blessure de l’estomac, et donc finalement une mort atroce.13 »
La chair est vendue dans certains marchés, et ceux qui en font commerce ne sont pas ceux qui tuent : « Moutons et chèvres sont tués dans un abattoir puis achetés par un boucher qui vend la viande. Il en va de même pour les buffles et les cochons, mais ces viandes sont proposées dans des boutiques spéciales. Les poissons sont vendus par les pêcheurs aux poissonniers des marchés. Les poulets, en revanche, sont vendus vivants et tués à la demande sur le marché14. » Les abandons de gros animaux qui sont recueillis dans des refuges sont importants. En 1998, la mode était aux petits chiens blancs qui étaient souvent abandonnés : « Ces chiens, physiquement en assez bon état, sont plus pitoyables que les chiens galeux des rues au crâne rongé. La vie ne les a pas cassés de la même façon : d’un côté, la dureté de la vie vagabonde, mais qui crée des forces de résistance car tout vient de soi ; de l’autre, l’égarement absolu propre à la situation d’abandon15. »
Lorsque Florence Burgat visite Old Delhi en 1998, ce sont « Ici et là, des étalages de boucherie. D’énormes quartiers de bovins pendent en pleine chaleur. Un peu plus loin, une trentaine de têtes de chèvres, non écorchées, sont posées les unes contre les autres sur une table basse presque à même le sol. Autour, de larges bassines de plastique bleu sont remplies de cadavres d’animaux dépouillés de petite taille que je n’identifie pas. Beaucoup de chiens errants cherchent un peu d’ombre sous les voitures. Une vache s’est arrêtée, là. Pourquoi là ? Sans ombre ni eau, sans répit, les bêtes sont condamnées à vivre dans ce brouhaha insupportable si contraire à leur attrait pour le calme et la lenteur16. »
À la même époque, de nombreux singes, dressés à faire des numéros pour touristes, sont abandonnés dans les refuges.
Une importante population de chiens errants souffre aussi en silence. En 1998, et depuis le milieu du XIXe siècle, les autorités municipales électrocutaient en masse les chiens errants. À Bombay, c’était deux cents chiens errants par jour qui étaient tués :
« Les camionnettes de ramassage tournaient jour et nuit pour capturer les bêtes et les conduire à la fourrière de Mahalaxmi. On les attrapait avec des pinces en fer munies d’un très long manche. Deux autres fourrières ont été ouvertes, les capacités de celle de Mahalaxmi étant devenues insuffisantes pour traiter les cadavres de chiens. Une usine de traitement des peaux appartenant à la municipalité, Korakendra, fabrique des articles en peau de chien17. » Pour autant, leur nombre n’a pas diminué et la rage n’a pas été éradiquée. Les associations de protection n’ont eu de cesse de soutenir une politique de stérilisation. En 2025, à New Delhi ils sont entre 800 000 et 1 million à errer dans la capitale. « La corruption, la paresse et l’apathie ont fait échouer ces politiques. En conséquence, les humains et les animaux souffrent tous. Les chiens errants se multiplient, ils meurent de faim, ils sont soumis à d’horribles cruautés. Des vies humaines sont perdues à cause de la rage et les chiens meurent blessés et dans la souffrance. Cette situation ne peut pas durer. Mais la solution ne réside pas dans un nettoyage autoritaire des rues18 ». Une politique de stérilisation et de vaccination pour lutter contre la rage est menée depuis plusieurs décennies et a été plus efficace que l’abattage en masse pour contrôler la propagation de la rage, notamment dans la ville de Goa19.
En Inde, l’accroissement spectaculaire de la population a été suivi d’un agrandissement des villes qui a détruit les habitats de millions d’animaux sauvages qui errent aujourd’hui dans les rues. Pour contrôler les naissances, en 2012, ce sont près de 4,6 millions de femmes qui ont été stérilisées dans le pays, la plupart dans des conditions sanitaires effroyables20. La question de la démographie est importante et épineuse. Comment éviter un accroissement exponentiel de la population mondiale sans recourir à de telles méthodes ? Il me semble que l’instruction laïque devrait être la priorité des États, une instruction qui permettrait de comprendre les enjeux écologiques de la surpopulation et qui valoriserait la sensibilité aux espaces naturels et aux autres espèces qui partagent notre incarnation terrestre.
En 2021, de la chair de cerfs, de sangliers, de chiens et de grenouilles était vendue illégalement dans les marchés d’animaux sauvages21. Chiens et singes sont également torturés pour « l’avancée médicale22 ». Des importations interdites d’espèces sauvages menacées d’extinction ont également cours, en toute impunité, dans le parc animalier de l’homme le plus riche d’Asie23.
Longtemps, les Hindous ont sacrifié des animaux à Kali, ou à Durga, déesse des orgies:
« Je contourne la foule et j’arrive devant le portique sous lequel on sacrifie les boucs. Deux mille par jour, parce que c’est Puja. Là aussi, il y a énormément de curieux et de fidèles. Je suis le seul blanc, mais en compagnie d’un brahmane du temple. Des boucs, des boucs, le sacrificateur s’active avec une prodigieuse dextérité et le sang éclabousse tout autour. Les têtes et les membres sont ramassés par d’habiles serviteurs. Encore chauds, les boucs égorgés passent de l’un à l’autre, on les écorche, on les découpe, on les vide, on les désosse. Je ne vois pas ce qui suit, mais la fumée qui monte me renseigne. On ne peut pas rester longtemps : les animaux hypnotisés par la peur et par l’odeur du sang s’abandonnent, pantelants, entre les mains exercées de l’immolateur. Les vapeurs de sang vous excitent, réveillent des instincts refoulés. Le soleil est brûlant, les gens vous bousculent, tous criant : ‘‘Duurga !… Duurga !…’’24 »
Dans l’hindouisme populaire, différent du brahmanisme, les sacrifices ont toujours cours. Dans l’Inde du sud, le panthéon de deux castes de pêcheurs est constitué d’un dieu supérieur végétarien et de divinités féminines inférieures carnivores. Les sacrifices sanglants par décollation, empalement, éventrement ou égorgement sont pour les divinités féminines et le choix des animaux non humains ont longtemps participé à maintenir le dualisme pur/impur qui structure toute la société hindoue25. Le sacrifice d’animaux est pratiqué dans les États d’Assam, d’Odisha, du Jharkhand, du Bengale occidental et du Tripura, dans l’est de l’Inde, ainsi qu’au Népal : « Des centaines de dévots hindous ont tranché le cou des bestioles agitées et en pleurs – parmi lesquelles des rats, des pigeons, des chèvres et des buffles d’eau– dans le cadre de ce rituel religieux auquel assistent adultes et enfants…26 » pour célébrer la déesse Gadhimai.
Dans les années 1970, la chasse a été interdite dans plusieurs États de l’Inde mais en 2014, la chasse contre les nuisibles (macaques rhésus, antilopes) et pour la subsistance a été autorisée. En 2016, sangliers, paons, antilopes, macaques, éléphants sont considérés comme une menace pour les fermiers et les habitants, et sont tués en masse27. Dans le Wildlife Protection Act, un article (n° 62) a été inclus pour permettre le classement dans la catégorie des nuisibles tout animal sauvage gênant, même s’il appartient à une espèce protégée. Si la législation indienne se borne à éviter les souffrances inutiles, rien ne rend illégal les expérimentations sur les animaux qui subissent quotidiennement des actes de cruauté28.
Dans les faits, 70 % de la population indienne mange de la viande29 mais méprisent ceux qui tuent. Néanmoins, si l’on compare avec la consommation des Occidentaux, elle reste modeste, son cout étant important. C’est que la sacralisation de la vache est bien plus un interdit politique qu’un interdit religieux.
Le mythe de la « vache sacrée » : exemple type d’une stratégie politique
Les conditions matérielles d’existence expliquent les croyances. Bien avant l’arrivée des musulmans avec l’arrivée des Moghols, le bœuf faisait partie de la tradition culinaire en Inde. La vache a été « sacrée » pour son utilité alimentaire :
« On appela la vache ‘‘Mère’’ parce que le lait de vache est le seul que l’on puisse comparer au lait maternel humain. […] ce n’est pas de la superstition, ce n’est pas une déification. C’est le résultat du constat que la vache est le seul animal qui vous donne autant de choses de valeur que votre mère le pourrait. Et quand la vache mourait, vous pouviez encore utiliser les cornes pour fabriquer divers objets, la peau pour faire des chaussures30. »
Mais sa sacralisation a surtout été une arme pour créer une identité nationale hindoue, structurer la population selon un continuum pur et impur dont les pôles opposés sont les hommes/les femmes, les brahmanes/les dalits, les hindous/les chrétiens et musulmans, etc.
Du XVIe au XVIIIe siècle, la « protection » de la vache a été une stratégie identitaire et nationaliste pour lutter contre les Moghols. Au XIXe, un mouvement contre l’abattage des vaches a été initié pendant la domination coloniale britannique pour s’y opposer et faire revivre le dharma hindou. L’Arya Samaj, mouvement réformateur monothéiste de l’hindouisme fondé à Bombay en 1875, a contribué à la protection des vaches. Ses idées réformatrices se répandront essentiellement au Pendjab où seront créés, en 1880, les Gau Rakshini Sabhas (Mouvements de protection de la vache). Les cas de violence communautaire dans divers États du nord de l’Inde ont provoqué des tensions entre hindous et musulmans. Les Britanniques ont toutefois maintenu une position neutre. Les journaux et publications en hindi ont également joué un rôle important dans la popularisation du mouvement pour la protection des vaches.
« Sa protection a participé de la construction d’une théologie unificatrice de la communauté hindoue, nommée aujourd’hui hindutva (« hindouité »). Celle-ci assimile la nation indienne à la majorité hindoue et réprime les minorités mangeuses de bœuf, au premier rang desquelles les 177 millions de musulmans (14 % de la population).31 »
Quand Florence Burgat a « visité » le quartier musulman de Old Delhi où se dresse la deuxième plus grande mosquée du monde, elle y a vu : « Sur les marches, des femmes assises, vêtues de noir, le visage entièrement couvert, attendent. Le voile qui cache leur visage empêche de distinguer le moindre de leur trait. L’atmosphère des quartiers musulmans est différente de tout autre. Trois millions de musulmans vivent ici. […] Autour de nous, des bêtes mortes exposées ici et là, des femmes entièrement voilées de noir marchant à l’aveugle…32 »
Si les femmes musulmanes subissent en effet d’inacceptables violences, le pays où la vache est « sacrée » est lui aussi un pays dangereux pour les femmes. En 2011, l’Inde était classée parmi les pays les plus dangereux au monde pour les femmes, derrière l’Afghanistan, la République Démocratique du Congo, le Pakistan et la Somalie33. En 2018, il devient le plus dangereux au monde, devant l’Afghanistan et la Syrie34. En 2025, ce sont des milliers de femmes qui sont tuées en Inde à cause de la dot bien qu’interdite depuis 196135.
La religion hindoue a permis à une civilisation patriarcale, fondée sur un système de « castes » de se maintenir et de s’adapter au capitalisme et aux technologies autoritaires :
« En quel temps vit l’Inde ? Langues et religions parmi les plus anciennes du globe, mais aussi techniques et productivité modernes ; rites archaïques et machinisme confondus ; strates du temps exposées côte à côte. Dans un champ, un maigre paysan enturbanné pousse devant lui un araire tiré par des bœufs, même pas un araire, mais l’aratrum romain, dépourvu de soc, image sans âge. Et au cours de la même journée, les siècles abruptement se succèdent ou se télescopent : le XIXe anglais (« Quelle était verte ma vallée ») dans certains affreux paysages miniers noircis de charbon, puis de nouveau un village et ses pièces d’eaux paisibles : virgilienne, égyptienne, mésopotamienne. Puis c’est de nouveau la pollution des slums [bidonvilles], puis la grande production technologique, industrieuse : côte à côte la grande ville, les usines et la publicité informatique, les chantiers et les villages où rien n’a changé depuis mille ans. Et puis les clivages sans pitié : aussi bien antiques (les castes) que contemporains (les classes) ; la laïcité dans la constitution et les guerres de religion dans les rues36. »
Les guerres interethniques et de religion sont toujours d’actualité en Inde. En 2023, dans l’État du Manipur (nord-est), les conflits entre Meitei (hindous) et Kuki (chrétiens et juifs) éclatent. Des Metei s’en prennent aux femmes Kuki : « Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre deux femmes de la tribu des Kuki, exhibées nues, traînées dans un champ, molestées par une foule d’hommes armés, des Meitei, l’ethnie dominante. […] Une troisième femme, âgée de 21 ans, a subi un viol collectif. Son frère et son père ont été tués par les assaillants.37 » Ces affrontements se poursuivent en 202538. Sous couvert de défendre le nationalisme indien, il en efface toute l’histoire musulmane héritée des Moghols. Le mépris, la haine, envers les musulmans n’aura jamais été aussi puissante. Sous prétexte de protéger la vache « sacrée », la politique menée par Narendra Modi est un nationalisme identitaire. Le mythe de la vache « sacrée » participe au mépris des hindous pour les musulmans et offre une bonne raison pour les persécuter39 :
« Le 28 septembre, dans un village du nord du pays, en Uttar Pradesh, 200 personnes ont lynché à mort un homme d’une cinquantaine d’années et grièvement blessé son fils sous prétexte que la famille avait mangé de la viande de bœuf. Le 9 octobre, au Jammu-et-Cachemire, une bombe artisanale a été lancée contre un camion transportant des vaches. Le jeune conducteur, musulman, a succombé à ses brûlures. Cinq jours plus tard, dans l’État voisin de l’Himachal Pradesh, un musulman de 20 ans suspecté de trafic de bovins a été battu à mort par plusieurs individus. Le 2 novembre, un autre a été tué par une foule d’hindous qui l’accusaient d’avoir volé une vache.40 »
Depuis 1950, la Constitution stipule que la compassion envers les animaux est un devoir des citoyens indiens, ce qui confère une légitimité aux actions de protection et contre la cruauté envers les animaux. Initialement rattachés au ministère de l’Agriculture, les Bureaux de la protection animale ont été transférés en 1990 sous la tutelle du ministère de l’Environnement (en France, la protection animale est toujours sous la tutelle du ministère de l’Agriculture). Ce changement leur laisse plus de marge de manœuvre mais n’est pas suffisant. Les lois de protection ne peuvent être efficaces que si les États donnent les moyens matériels aux différents acteurs de les mettre en place. Des « milices de protection de la vache » s’attaquent en toute impunité aux chrétiens et musulmans, mais aussi au hindous les plus pauvres, c’est que la priorité du gouvernement de Modi est avant tout l’identité hindoue construite autour de la « vache sacrée » et non la compassion pour les vaches.
L’Inde, tout comme l’Occident, et comme de nombreux autres peuples, traite différemment humains et non-humains selon leur utilité. Là où notre civilisation sépare nature/culture, humain/animal, l’hindouisme distingue le pur et l’impur.
« Mais cette figure-là du monde, où les styles, les époques, les modes de production et d’existence se côtoient, n’est-elle justement pas en train de naître, au cœur de notre monde privilégié, dans les désordres qu’il connaît, dans la confrontation croissante entre les riches et les pauvres, le Nord et le Sud, le luxe de Park Avenue et les zones ruinées du Bronx ? L’Inde n’est-elle pas une anticipation accomplie de ce qui va bientôt être la figure unifiée du globe ? Car bientôt nous serons soumis à deux causes extrêmes de désordre, de violence, de ruine : les effets anarchiques de l’industrialisation et le déferlement des pauvres. C’est ainsi que notre monde s’unifiera et tel sera son principe d’unification, la violence, la pollution, la pauvreté. Notre avenir est là, dans ce côtoiement mortel entre l’extrême technique et l’extrême survivance du passé, entre l’extrême richesse et l’extrême pauvreté41. »
Conclusion
Comme nous l’avons vu précédemment, végétarisme (tout relatif), philosophie de non-violence (Ahimsa), sacralisation de la vache, n’impliquent nullement une société juste et sans classes. Chez les brahmanes, la consommation de chair est interdite non par compassion mais par horreur de la souillure, par répugnance pour la chair. Les castes supérieures utilisent le végétarisme pour se distinguer, comme les nobles d’Europe se distinguaient en chassant et mangeant du cerf et du sanglier. L’« éthique » végétarienne hindoue est une autre manière de maintenir une société de classes par une « philosophie » de non-violence, de karma et de mépris pour l’incarnation.
Nous avons de multiples raisons de critiquer l’Occident, mais, ainsi que l’a écrit Danièle Sallenave dans son livre Le principe de ruine : « Nous ne sacrifions plus d’hommes depuis Abraham, non plus : ni, depuis le Christ, d’animaux. J’aime ce chemin qui nous a menés d’Isaac à l’agneau et de l’agneau à l’hostie de pâte levée. Et je ne le regrette pas, quand je vois les poteaux de la sanglante Kali rougis par le sacrifice…42 » Sans être croyante, force est de constater que depuis les premières domestications, les sacrifices n’ont cessé de nourrir les démons des civilisations. Mais je ne peux m’empêcher de concevoir nos abattoirs comme des lieux de sacrifice de masse qui participent à maintenir le désordre du monde, en l’occurrence le suprématisme que s’est octroyé l’espèce sapiens sur toutes les autres.
Ana Minski, novembre 2025
Corrections : Lola
Notes
1https://idele.fr/detail-article/mmx2024-viande-bovine-en-inde-production-en-hausse-mais-potentiel-sous-exploite
2https://netap.ch/fr/portfolio/vaches-inde/
3https://www.freepressjournal.in/lifestyle/who-will-bell-the-cow-author-shruti-ganapatyes-debut-novel-tries-to-decode-complex-religious-and-political-narrative-over-beef-ban
4Florence Burgat, Le mythe de la vache sacrée. La condition animale en Inde, Payot, 2017, p. 209
5Pier Paolo Pasolini, L’odeur de l’Inde, 1961, p.
6Burgat, 2017, p. 39
7Ibid., p. 57
8Ibid., p. 92
9https://www.nationalgeographic.fr/animaux/espece-invasive-asie-inde-ils-sont-cinq-millions-ils-detruisent-tout-mais-ils-sont-sacres
10« Le sikhisme, ou Sikhi, est une religion dharmique monothéiste fondée dans le Pendjab, au nord du sous-continent indien, au XVe siècle. Elle est de nos jours la cinquième religion par le nombre de croyants, avec environ 30 millions de pratiquants, derrière le bouddhisme, l’hindouisme, l’islam et le christianisme. » Wikipedia, consulté le 21 novembre 2025.
11https://idele.fr/
12in Burgat, 2017, p. 216
13https://netap.ch/fr/portfolio/vaches-inde/
14Op. cit., p. 70
15Ibid., p. 35
16Ibid., p. 118
17Ibid., p. 123
18https://www.lemonde.fr/international/article/2025/09/01/en-inde-le-debat-passionne-autour-des-chiens-errants_6637969_3210.html
19https://www.lemonde.fr/international/article/2025/09/01/en-inde-le-debat-passionne-autour-des-chiens-errants_6637969_3210.html
20https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/11/11/sterilisations-de-masse-en-inde-au-moins-dix-femmes-meurent_4521987_3216.html?search-type=classic&ise_click_rank=19
21https://www.petafrance.com/actualites/enquete-marches-illegaux-animaux-sauvages-viande-chien-inde/
22https://www.petafrance.com/espace-media/revelations-des-chiens-en-sang-et-des-singes-malades-dans-un-grand-laboratoire-sous-contrat-en-inde/
23https://www.lemonde.fr/planete/article/2025/11/23/l-inde-malgre-les-transferts-douteux-d-animaux-vers-le-mega-zoo-prive-de-vantara-echappe-a-des-restrictions-sur-ses-importations_6654559_3244.html
24Mircea Eliade in Burgat, 2017, p. 208
25Olivier Herrenschmidt, « Les formes sacrificielles dans l’hindouisme populaire », Systèmes de pensée en Afrique noire, 3 | 1978, 115-133.
26https://www.slate.fr/monde/festival-plus-sanglant-monde-200000-animaux-sacrifies-nepal-massacres-pigeons-rats-buffles-eau-sacrifice-betes-gadhimai
27https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/proliferation-des-herbivores-l-inde-choisit-l-abattage-massif_103033
28https://www.petafrance.com/actualites/les-dessous-de-lun-des-plus-grands-laboratoires-dinde-des-beagles-blesses-et-des-cochons-en-sang/
29https://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/05/comment-traite-t-on-les-animaux-au-pays-de-la-vache-sacree_6005643_3244.html
30Burgat, 2017, p. 73
31https://www.monde-diplomatique.fr/2016/02/DESQUESNES/54703
32Op. cit., p. 117 et 119
33https://www.lemonde.fr/societe/article/2011/06/15/l-afghanistan-la-rdc-le-pakistan-l-inde-et-la-somalie-sont-les-cinq-pays-les-plus-dangereux-pour-les-femmes_1536268_3224.html?search-type=classic&ise_click_rank=27
34https://www.courrierinternational.com/article/classement-linde-pays-le-plus-dangereux-du-monde-pour-les-femmes
35https://theconversation.com/en-inde-des-milliers-de-femmes-sont-tuees-chaque-annee-a-cause-de-la-dot-pourtant-interdite-depuis-plus-de-soixante-ans-249313
36Danièle Sallenave, Le principe de ruine, Gallimard, 1994, p. 62
37https://www.lemonde.fr/international/article/2023/07/21/en-inde-une-video-abjecte-contre-des-femmes-ravive-les-violences-dans-le-manipur_6182873_3210.html?search-type=classic&ise_click_rank=8
38https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/focus/20250716-deux-ans-plus-tard-le-conflit-ethnique-s%C3%A9vit-toujours-dans-l-%C3%A9tat-indien-du-manipur
39https://www.nouvelobs.com/monde/20240512.OBS88269/en-inde-l-argument-de-la-protection-des-vaches-est-utilise-par-les-mouvements-d-extreme-droite-anti-musulmans.html
40https://www.monde-diplomatique.fr/2016/02/DESQUESNES/54703
41Sallenave, 1994, p. 62 et 63
42Ibid., p. 55