Articles récents
- “S’engager dans la recherche et inventer une méthodologie féministe” (Renate Klein)
- RENATE KLEIN. Introduction à son œuvre (par Annie gouilleux)
- “Nous tirer une balle dans le pied” (par Jo Brew)
- “Les Women’s Studies et les hommes”, de Renate Klein (par Annie Gouilleux)
- « La passion de l’amitié, vers une philosophie de l’affection féminine » de Janice Raymond (par Annie Gouilleux)
Liens
- Mouvement du nid
- Ressources prostitution
- La révolution sera féministe
- Blog Révolution féministe
- Tradfem
- Scènes de l’avis quotidien
- Sniadecki – Critique de la science
- Les amis de Bartleby
- Sciences-critiques
- Polemos – Postcroissance
- Coalition internationale contre la maternité de substitution
- Podcast Rebelles du genre
Activisme Aliénation Anarchisme Andrea Dworkin Annie Gouilleux Anthropologie Antiprogressisme Archéologie Art paléolithique Aurélien Berlan Biogynophobie Capitalisme Capitalisme vert Charles Stepanoff Chasse Critique de la civilisation critique de la science Culture masculiniste Domestication Démystification Enfance Francis Dupuis-Déri Féminisme Féminisme radical GPA Histoire Identité de genre ITW Littérature Note de lecture Patriarcat Poésie Prostitution Racisme Revue Behigorri Rêve Sagesses Incivilisées Technocritique Technoscience transactivisme Transhumanisme Vidéos Violence masculine Écoféminisme Écologie
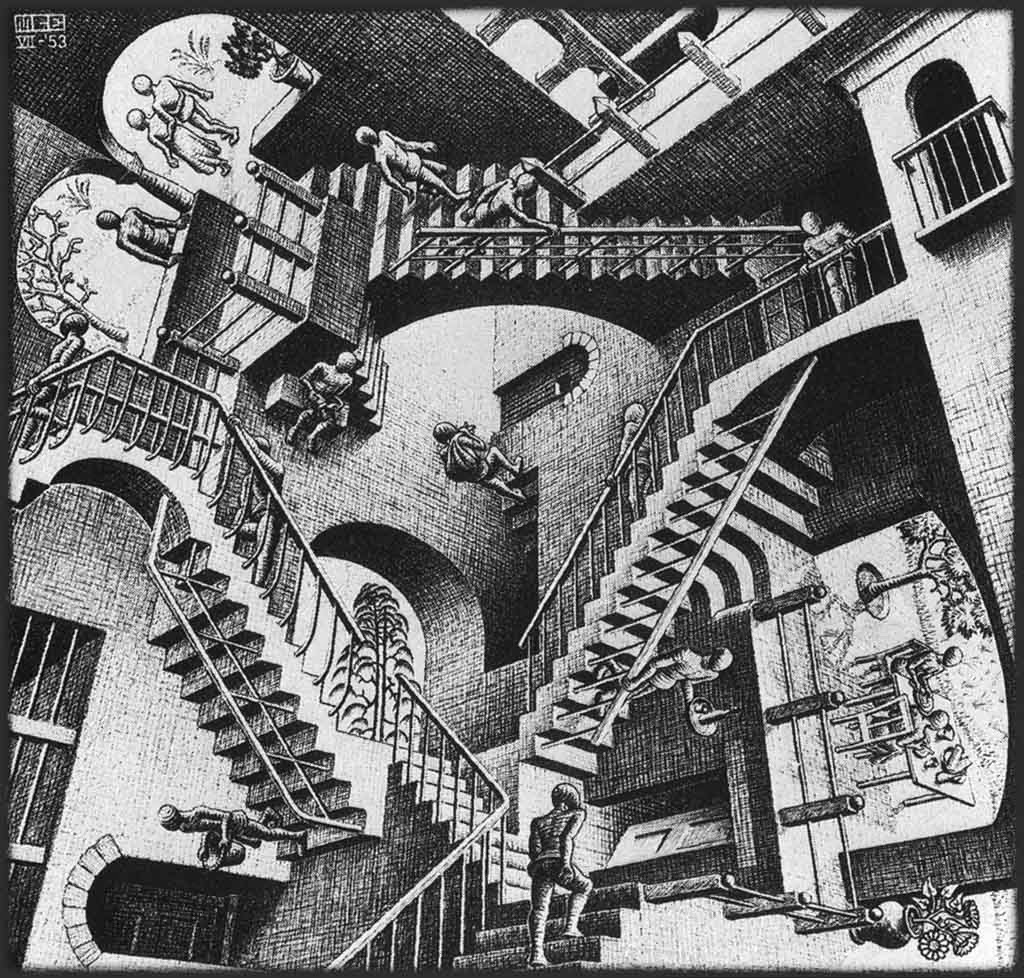

Le mythe de la science pure par Guillaume Carnino
Cet article de Guillaume Carnino a été publié en mai 2006 dans la revue Offensive n°10, numéro consacré à l’impérialisme de la science et téléchargeable en cliquant sur le lien : https://offensiverevue.files.wordpress.com/2015/02/offensive10.pdf
Les catastrophes scientifiques seraient le fruit des sciences appliquées par des industriels ou des États. Mais existe-t-il une science pure dénuée d’intérêt et sans lien avec les puissants ?
La différence même entre sciences pures et sciences appliquées n’existe réellement chez aucun des grands fondateurs de ce que l’on nomme aujourd’hui la science[1]1À laquelle on pense quand on dit quelque chose comme : « La science pourrait sans aucun doute expliquer ceci ou cela ».. Loin de son image rebattue de rationaliste militant, Newton a passé une grande partie de sa vie à écrire sur la numérologie biblique[2]2John Fauvel (dir.), Let Newton Be !, Oxford University Press, 1990.. Pourtant, il n’y a pas eu deux Newton (ou même trois, puisqu’il fut aussi directeur de la Monnaie). Ce que l’on considère comme de la pure science aujourd’hui n’en est peut-être que pour nous.
Otto Sibum a récemment relaté la reconstitution de l’expérience que Joule a réalisé tout au long de sa vie (afin de déterminer la constante baptisée en son nom, qui permet d’établir un lien entre travail mécanique et chaleur)[3]3H. Otto Sibum, « Les gestes de la mesure. Joule, les pratiques de brasserie et la science », in Annales. Histoire, sciences sociales, juillet-octobre 1998, n°4-5, pp. 745-774.. Alors que ses comptes-rendus ne font pas état de précautions particulières quant à la mesure des températures, la réalisation même de l’expérience implique de lever plusieurs fois un poids de vingt-six kilos afin d’actionner un dispositif, ce qui amène l’expérimentateur, par son effort, à chauffer la salle et à fausser les mesures. Pourtant, Joule avait atteint une précision invraisemblable, sans pour autant disposer des instruments de mesure électroniques d’aujourd’hui : Joule était fils de brasseur, il était de ces hommes qui passent leur vie à mesurer la température de fermentation des cuvées de bière au vingtième de degré près…
Les comptes-rendus sont trompeurs par leur abstraction et il faut un grand savoir-faire expérimental pour obtenir des données scientifiques. Heinrich Hertz, qui découvrit les ondes radio, s’était trompé dans un calcul, et les résultats chiffrés de sa fameuse expérience aboutissent à une vitesse ondulatoire aberrante, supérieure à celle de la lumière. Pourtant, l’ingéniosité de son dispositif, repris et amélioré par d’autres au cours de cette mémorable controverse, fait bien de lui l’inventeur éponyme de ces ondes[4]4Michel Atten et Dominique Pestre, Heinrich Hertz. L’administration de la preuve, PUF, 2001.. Certains auteurs théorisent même cette capacité qu’a la technique à imposer des concepts ou théories et parlent d’« universalité pratique », ce qui revient presque à dire que la vérité de la science n’est pas ailleurs que dans la technique qu’elle met en œuvre et qui la produit[5]5Terry Shinn et Pascal Ragouet, Controverses sur la science. Pour une sociologie transversaliste de l’activité scientifique, Raisons d’Agir, 2005.. Savoir, c’est savoir qu’on sait faire, c’est pouvoir reproduire une expérience ou un appareil[6]6Harry Collins, « The TEA Set : Tacit Knowledge and Scientific Networks », Science Studies n°4, 1974, pp. 165-186., c’est donc dès l’origine disposer d’un pouvoir effectif sur le réel.
La pratique scientifique ne s’est pas purifiée avec le temps. Peter Galison montre bien l’importance qu’a eu le travail d’Einstein au sein du Bureau des brevets, à Berne, où il était en contact direct avec les problèmes de synchronisation des différentes horloges dans les gares d’Europe (à une époque où une gare comme Zurich pouvait disposer de quatre cadrans différents, affichant les heures de plusieurs capitales européennes simultanément)[7]7Peter Galison, L’Empire du temps. Les horloges d’Einstein et les cartes de Poincaré, Robert Laffont, 2005.. La théorie de la relativité (du temps et de l’espace) n’a pas surgi miraculeusement d’un esprit soudainement et inexplicablement illuminé.
Aujourd’hui même au CERN, le principal centre d’études européen en physique des hautes énergies, Galison a recensé plusieurs types de scientifiques différents, dont le travail est de traduire, chacun à leur niveau, les théories les plus abstraites en direction des scientifiques de niveau « inférieur », et ce, jusqu’aux expérimentateurs : les accélérateurs de particules qui s’y trouvent nécessitent plusieurs centaines de personnes pour fonctionner quotidiennement[8]8Peter Galison, Image & Logic. A Material Culture of Microphysics, University of Chicago Press, 1997.. Depuis ses origines et jusqu’à l’époque contemporaine, la science a toujours été technique. La science moderne est d’emblée appliquée.
Faire de la science n’est rien d’autre que produire des faits à partir de machines[9]9Dominique Pestre, «Les sciences pour la guerre», conférence à la Cité des sciences et de l’industrie, 17 novembre 2005.. Et cela n’est pas neutre, comme les prémices de la révolution scientifique le montrent.
À l’origine, la guerre
L’utilisation massive du métal (matériau robuste mais peu malléable) pour l’artillerie de la Renaissance, est entre autres à l’origine de la mesure systématique (qui n’était pas nécessaire avec le bois, où tout pouvait être ajusté sur place), elle-même à la racine des nombreux instruments qui autoriseront Galilée et ses successeurs à voir le grand livre de la Nature « écrit en langage mathématique »[10]10Jean Baudet, De l’Outil à la machine. Histoire des techniques jusqu’en 1800, Vuibert, 2003, p. 161.. Les artisans de cette révolution sont des ingénieurs (comme Léonard de Vinci)[11]11Bertrand Gille, Les Ingénieurs de la Renaissance, Seuil (Points), 1er éd. Hermann, 1964.. Or, ces hommes étaient avant tout des gens de guerre au service du pouvoir.
Les ingénieurs de la Renaissance fabriquent les « engins » (c’est-à-dire les machines de guerre), ils fortifient les châteaux et mènent les sièges : le calibrage des boulets au XVIe siècle pose ainsi les premiers jalons de la standardisation. Accessoirement, leur savoir-faire peut aussi être employé en temps de paix, mais là n’est pas l’essentiel de leur fonction et de leur savoir. Toutes les tâches de l’ingénieur, ancêtre du scientifique, sont orientées vers la guerre. On peut alors détourner Clausewitz[12]12«La guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens»: Karl von Clausewitz, De la Guerre, Les Éditions de Minuit, 1955. et considérer que science et technique sont une continuation de la guerre par d’autres moyens : que ce soient des moyens guerriers inédits, ou bien simplement l’invention de la pacification sociale via l’urbanisme, la production mécanisée, etc. Ces ingénieurs sont indispensables aux princes de l’époque (qui se les arrachent) pour mener leurs campagnes militaires – et de plus en plus pour administrer le quotidien.
Alors qu’ingénieurs et constructeurs du Moyen âge étaient d’obscurs anonymes, ils deviennent célèbres et respectés à partir de la Renaissance. Savoir et pouvoir n’étaient alors pas considérés comme antinomiques (ce que laisse aujourd’hui croire l’idée de science fondamentale détachée des enjeux sociaux). Si le théologien était bien supérieur au philosophe, qui lui-même dominait le mathématicien, c’était parce que la source du pouvoir de la connaissance se situait dans le suprasensible. Le savoir théologique et religieux était le plus « reconnu » car c’était celui qui entretenait la plus grande distance avec la matière. Cette hiérarchie chère à Aristote et à ses disciples médiévaux est inversée par les ingénieurs, qui sont justement des artisans de la matière.
Désormais, le savoir (des ingénieurs) confère un pouvoir redoublé : c’est parce que ce savoir permet d’agir sur la matière que les puissants le récompensent. Jadis, le savoir était pouvoir parce qu’il était éloigné de l’action directe sur les choses. Dorénavant, le savoir procure du pouvoir social lorsqu’il permet d’exercer un pouvoir sur la matière même du monde. Le rapport entre savoir, pouvoir et matérialité du monde s’est inversé, et le pouvoir se redouble désormais dans le savoir lui-même. Les savants sont à l’époque presque toujours des courtisans vivant du mécénat intéressé des princes qui en retirent puissance et renommée. Ainsi, Galilée dédicace-t-il les satellites de Jupiter (qu’il découvre avec sa lunette) au grand duc de Toscane en les baptisant « astres médicéens »[13]13Mario Biagioli, Galileo Courtier, The Practice of Science in the Culture of Absolutism (Galilée courtisan), The University of Chicago Press, 1993.. Courtisans ou aristocrates, les hommes de science le seront au moins jusqu’à la Révolution : ils se font appeler Lord Kelvin, Sir Newton, marquis de Laplace, comte de Lagrange, etc.
Sciences et pouvoir
La controverse entre Hobbes et Boyle au sujet de l’existence du vide est le théâtre d’une innovation importante : la séparation fantasmée entre savoir et pouvoir[14]14Steven Shapin et Simon Shaffer, Léviathan et la pompe à air. Hobbes et Boyle entre science et politique, La Découverte, 1993.. Boyle, membre de la Royal Society of London, réunit des gentlemen et des pairs du royaume pour assister à des expériences où des pompes aspirent l’intérieur de récipients en verre, dans lesquels on place toutes sortes de choses (des oiseaux qui s’asphyxient, de la neige qui fond, etc.) pour y démontrer la « présence » du vide.
Hobbes dénie toute valeur à ces expériences, qualifiant ce petit groupe de secte, dont les actes (selon lui éminemment politiques) n’auraient pas plus de légitimité que ceux de n’importe quel autre groupement d’intérêt. Mais Boyle ne s’en laisse pas conter : il affirme la neutralité de son dispositif, prétend ne faire rien d’autre que révéler le réel et fait signer ses récits d’expérience par les aristocrates présents. Ce qui fait preuve, c’est le témoignage de gens de la haute société, dont la parole ne peut être remise en cause. Un fait est alors établi indiscutablement par la présence de gens de pouvoir, puisque ceux qu’il faut convaincre ne sont pas les paysans, mais la bonne société dans son ensemble. Le savoir de Boyle, apparemment désintéressé, est très utile aux puissants, puisque, par le geste même où il expérimente sur le vide, il devient capable de réutiliser (puis de perfectionner) sa pompe pour une utilisation hydraulique urbaine, ou dans des jardins royaux.
Technoscience et pouvoir se couplent alors : par le geste scientifique lui-même (expérimenter avec une pompe à vide), la technique peut servir les puissants (par exemple être utilisée en urbanisme), c’est-à-dire transformer la société. Le pouvoir valide le savoir scientifique, qui produit en retour des techniques utiles au pouvoir. Le paradoxe est que cet échange réciproque entre savants et puissants instaure dans les discours le grand partage entre savoir et pouvoir, vu comme incompatibles depuis cette date. En réalité, c’est sans doute en raison du pouvoir que procure la pratique scientifique que son lien avec la domination et les intérêts politiques ou financiers est rendu invisible depuis.
L’autonomie de la science
On peut poursuivre cette histoire de la preuve[15]15Histoire menée par Christian Licoppe, La Formation de la pratique scientifique, La Découverte, 1996. et s’apercevoir que l’autonomie scientifique est acquise quand les structures politiques et sociales rendent nécessaires la présence d’experts pour légitimer leur pouvoir. Les révolutions, comme celle de 1789, seront souvent le théâtre d’un divorce entre savants et une certaine forme de témoignage aristocratique, pour des raisons politiques évidentes (la noblesse a alors une sale odeur de guillotine), mais aussi pour d’autres qui le sont moins.
C’est dès le XIXe siècle (l’héritage de 1789 y est évidemment pour beaucoup) que « l’autorité ne peut plus être discrétionnaire : elle appelle consultation, expertise, argumentation sur des faits précis et mesurables, jugement sur l’opinion »[16]16Jean-Pierre Daviet, La Société industrielle en France. 1814-1914, Seuil, p. 131.. Lorsque le pouvoir était de droit divin, il avait besoin des religieux pour être légitime et validé. L’Église se devait donc de disposer d’une certaine autonomie face au souverain. Lorsque le pouvoir n’est plus fondé sur la divinité, mais sur le gouvernement des hommes, il lui faut encore être en capacité de se justifier. Si les décisions du pouvoir sont toujours parées des attributs de la nécessité, ce n’est plus par la grâce du Ciel, mais au nom des lois de la Nature[17]17Jean Ehrard (L’Idée de nature en France à l’aube des Lumières, Flammarion, 1981) note justement que le concept de Nature possède de forts relents divins à l’aube des Lumières..
Les scientifiques rentrent alors réellement en scène, car ils fournissent l’expertise nécessaire à légitimer les actions du pouvoir. C’est ainsi qu’une réelle (mais partielle) autonomie du champ scientifique est acquise. Au XIXe siècle, la notion de Progrès permettra à la bourgeoisie de prétendre « légitimement » prendre en charge le destin de l’humanité. La science participe au pouvoir au nom de sa neutralité fantasmée, de sa capacité à dire le vrai du monde. Les scientifiques peuvent donc à la fois prétendre servir le bien de l’humanité et être neutres, tout en obtenant des fonds (nécessaires à leurs institutions de plus en plus nombreuses) auprès des structures étatiques modernes en faisant valoir l’intérêt qu’ils représentent pour l’industrie, la défense, etc. Le champ scientifique est né, son double discours est permanent (et il existe plus que jamais aujourd’hui), mais il ne s’adresse pas aux mêmes personnes et n’a pas toujours la même fonction. Il faut apaiser les dominé-e-s et prétendre œuvrer pour leur bien tout en intéressant les élites politiques et industrielles pour obtenir des subsides, et bien rappeler, lorsque les sciences produisent quelques maux, que seule leur application mal intentionnée est à mettre en cause.
Science, vérité et jeux de pouvoir
La notion de science au singulier émerge à la même période. Il existait auparavant des philosophes naturels, des gens qui œuvraient dans les sciences, alors même qu’ils étaient « pluridisciplinaires », selon nos critères contemporains : Descartes ou Leibniz sont connus pour leurs apports mathématiques, physiques, aussi bien que philosophiques, théologiques, etc. Au moment même où les disciplines se segmentent et se cloisonnent, l’idée d’une science au singulier apparaît. On va alors retrouver ses racines chez des fondateurs comme Bacon, Galilée ou Newton (que l’on réinvente au passage), alors même que leurs projets n’étaient pas posés en ces termes.
Mais le retournement le plus intéressant reste celui qui aboutit à l’idée de science pure. Cette idée émerge à l’époque où les scientifiques sont justement, à l’issue de la seconde révolution industrielle, les plus impliqués dans les développements technoscientifiques modernes. Au moment où sciences, techniques et grand capital travaillent presque toujours main dans la main, l’idée d’une science pure apparaît. Sa fonction d’idéologie mystificatrice est évidente, et une telle idée n’avait guère de sens pour un Galilée qui dédiait les satellites de Jupiter à Cosimo de Médicis. Elle devient par contre nécessaire au moment où la science est censée détenir le Vrai, ce qui lui permet de concevoir, articuler, graisser et réparer – mais surtout légitimer – les mécanismes et rouages du pouvoir politique, industriel et financier dans les sociétés contemporaines.
Certains religieux ne voyaient pas de danger dans l’héliocentrisme de Copernic car, pour eux, cette théorie pouvait n’être qu’une hypothèse commode sans rapport avec le monde réel. À l’heure où la science – et non plus l’Église – est censée dire le Vrai du monde, son soutien au pouvoir est absolument indispensable. Pire, il doit être le plus inconditionnel possible, comme la privatisation récente de nombreux développements scientifiques le montre.
Dès lors, puisque les scientifiques eux-mêmes s’accusent parfois mutuellement de tronquer leurs résultats, voire de ne pas raisonner ou expérimenter scientifiquement, on peut penser que l’intérêt de la notion de science au singulier est surtout idéologique : elle permet de disqualifier un discours adverse – qu’il émane des masses populaires non expertes et souffrant de « radiophobie » (sic)[18]18Concept inventé par les technocrates d’EDF visant à disqualifier le rejet du nucléaire par les populations civiles., ou de confrères astrophysiciens opposés dans des querelles de très haut niveau – et de légitimer le sien. Si ce qui est scientifique est objectif et vrai, c’est-à-dire réel et inéluctable, alors il est primordial de pouvoir dire que les chiffres du chômage sont mesurés scientifiquement, que les OGM sont issus de la science, qu’une solution scientifique est à l’étude au sujet des déchets nucléaires, etc. Ad nauseam.
Bruno Latour élabore une saisissante analogie :
La science au singulier, la science contemporaine, la science impérialiste, naît et prolifère grâce au capitalisme industriel et à l’État moderne. On peut gager qu’elle les servira encore longtemps.
Guillaume Carnino
References[+]